
Le projet « DeadWood4Forests », fruit d’une collaboration entre l’ULiège, le Centre National de la Propriété Forestière, TER-consult, Forêt.Nature et la Société Royale Forestière de Belgique, met en lumière l’importance capitale du bois mort pour des forêts vivantes et plus résilientes. Longtemps perçu comme un simple déchet, le bois mort est aujourd’hui reconnu comme un composant indispensable des écosystèmes forestiers, jouant un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité et des processus écologiques essentiels.
Les rôles vitaux du bois mort dans l’écosystème forestier
Le bois mort, qu’il soit sur pied (chandelle) ou au sol, intervient à de multiples niveaux dans le fonctionnement de la forêt. Sa décomposition, qui commence dès la mort de l’arbre ou de ses parties, est un processus complexe influencé par la température, l’humidité, la taille de la pièce de bois et sa composition chimique. Les feuillus se décomposent généralement plus rapidement que les conifères.
- Biodiversité : Un habitat crucial
Environ 25% des espèces forestières dépendent du bois en décomposition pour au moins une partie de leur cycle de vie, incluant des milliers d’espèces d’insectes, de champignons, d’oiseaux (comme les pics), de chauves-souris, de petits mammifères et d’amphibiens. La diversité des types de bois mort (tailles, essences, stades de décomposition, exposition) est primordiale pour maintenir des communautés saproxyliques fonctionnelles. Les très gros bois, morts ou vivants, sont particulièrement favorables à l’accueil de cette biodiversité. - Cycles des nutriments et du carbone : la fertilité du sol
Le bois mort est un réservoir important de carbone et d’éléments nutritifs. Au fur et à mesure de sa décomposition, les organismes décomposeurs (principalement champignons et bactéries) libèrent progressivement ces nutriments (azote, phosphore, calcium, etc.) dans le sol, les rendant assimilables par les plantes. Les bois de feuillus ont généralement un effet plus favorable sur le sol que ceux des conifères. Maintenir du bois mort en forêt contribue significativement à maintenir et restaurer la fertilité de la station forestière et, par conséquent, la production de bois. Les récoltes intensives de rémanents peuvent entraîner de très fortes exportations d’éléments minéraux, impactant négativement la fertilité des sols. - Rétention d’eau et régénération naturelle
Le bois mort, surtout au sol et en décomposition avancée, peut accumuler une importante proportion d’eau, jouant un rôle clé dans un contexte de sécheresses croissantes. Cette humidité stimule l’activité mycorhizienne du sol et améliore sa porosité, ce qui lui permet de retenir davantage d’eau. Il sert également de substrat efficace pour la régénération naturelle de certaines essences comme l’épicéa commun et le sapin pectiné, en particulier les bois de grand diamètre. - Protection contre les perturbations et risques
Le bois mort agit comme une barrière naturelle contre le broutage des jeunes plants par les ongulés sauvages (chevreuils, cerfs). Il peut également limiter l’érosion des sols en terrain pentu. Contrairement à une idée reçue, la conservation disséminée d’arbres-habitats ou de bois morts n’a pas d’influence sur le risque d’épidémie de ravageurs. Au contraire, la présence de vieux arbres et de bois en décomposition peut accueillir les prédateurs et parasitoïdes des organismes ravageurs, contribuant ainsi au contrôle biologique.
Concernant les incendies, la principale cause est humaine. Les gros bois morts très décomposés ont une faible inflammabilité en raison de leur forte teneur en eau. Après un incendie, le maintien du bois mort sur site est recommandé pour favoriser la régénération, fournir de l’ombrage et protéger le sol de l’érosion. - Rôle dans les cours d’eau
Dans les cours d’eau, les accumulations de bois mort (embâcles) jouent de nombreux rôles écologiques : ils créent des habitats pour de nombreuses espèces, augmentent l’hétérogénéité morphologique du cours d’eau, freinent l’écoulement (limitant la violence des crues) et participent à la formation de mouilles, utiles en période de sécheresse. Le bois mort dans l’eau contribue également à la dénitrification.
Un retard wallon à combler
Malgré ces avantages, la Wallonie accuse un retard important en matière de quantités de bois mort par rapport à ses voisins européens. En 2015-2023, les forêts wallonnes contenaient en moyenne 12,3 m³/ha de bois mort (avec un seuil de mesure de 7 cm de diamètre), soit seulement 4,4% du bois vivant. En comparaison, les pays et régions limitrophes atteignent des volumes nettement supérieurs : près de 20 m³/ha au Luxembourg (il y a 20 ans), plus de 20 m³/ha en France, et entre 33 et 38 m³/ha en Allemagne en 2022. Le nombre d’arbres morts par hectare en forêt publique wallonne n’est que de 0,65 arbre/ha.
Les normes wallonnes actuelles concernant le bois mort et les arbres d’intérêt biologique (AIB) sont jugées trop limitées et insuffisamment mises en œuvre. Par exemple, la norme wallonne est de 0,5 AIB/ha, contre 2 à 10 AIB/ha chez les voisins.
L’analyse des martelages effectués par le DNF depuis 30 ans révèle qu’une quantité non négligeable de bois de faible valeur économique (bois cassés, secs, gélivés, porteurs de champignons, etc.) est actuellement exploitée et pourrait potentiellement être laissée en forêt pour augmenter le stock de bois mort. De même, les houppiers et autres reliquats (qui représentent près d’un quart des volumes martelés en feuillus) constituent une large réserve potentielle de bois mort s’ils étaient tous réservés à la nature.
Les crises sanitaires, comme celle du hêtre à la fin des années 1990, sont identifiées comme des opportunités majeures pour augmenter le volume de bois mort. L’exploitation systématique des arbres malades, bien que visant à sauver un capital économique, a eu des impacts négatifs sur la durée de la crise, les prix du marché et la santé des sols, alors qu’une non-intervention aurait pu restaurer des niveaux intéressants de nécromasse et de biodiversité.
Perceptions et freins au changement
L’enquête sociologique du projet a révélé plusieurs freins au maintien du bois mort. Les gestionnaires forestiers publics, bien que reconnaissant son importance pour la biodiversité, manquent souvent de connaissances précises sur les espèces dépendantes. Les préoccupations économiques, notamment pour le chêne, restent un frein majeur. Des jugements esthétiques (« forêt propre ») persistent, et la crainte des risques sanitaires (scolytes notamment) conduit à des coupes préventives, même si les agents savent que cela n’est pas toujours justifié.
Les propriétaires privés, tout en ayant une perception globalement positive du bois mort, le considèrent souvent comme une question « non-prioritaire » et sont réticents à laisser des arbres valorisables économiquement. L’influence des gestionnaires forestiers, perçus comme des « experts », est significative. La sécurité (risque de chute) est une préoccupation majeure, poussant à l’abattage d’arbres proches des chemins.
Analyse coûts/bénéfices : un investissement rentable à long terme
L’analyse économique du rapport montre que le « manque à gagner » lié au maintien du bois mort est souvent marginal, voire nul, dans des conditions d’exploitation complexes (pentes fortes, sols humides) ou sur des terrains peu productifs. Pour un arbre-habitat de grande taille, la perte financière maximale est estimée à environ 7€/an dans des conditions très favorables (chêne en productivité élevée, exploitation aisée).
Le bois mort et les arbres-habitats génèrent de nombreux services écosystémiques (appelés « contributions de la nature aux sociétés et au bien-être humain » ou NCP par l’IPBES), dont la valeur économique dépasse souvent la perte de revenus liée à l’exploitation. Par exemple, la production de bois ne représente que 32% de la valeur économique totale d’une forêt étudiée en Bavière, les autres services (protection de l’eau, régulation climatique, biodiversité) constituant 68%.
Propositions pour une stratégie wallonne intégrative
Le projet propose une stratégie ambitieuse pour la Wallonie, articulée autour de trois objectifs biologiques :
- OB1 : Réserver à la libre évolution au moins 10% du territoire forestier wallon (Réserves Intégrales Forestières – RIF et Îlots de Sénescence – IS). À long terme (2050), cet objectif pourrait dépasser 20% pour les forêts domaniales, notamment celles sur sols marginaux.
- OB2 : Réserver au moins 10% des arbres en dehors des zones en libre évolution (Bouquets d’Arbres-habitats – BA et Arbres-Habitats – AH). La norme idéale serait de 10 AH/ha, incluant au moins 4 arbres morts et 4 arbres d’intérêt biologique par hectare.
- OB3 : Atteindre un volume moyen régional de bois mort de 40 m³/ha (seuil d’inventaire de 10 cm de diamètre) dans les forêts feuillues ou mixtes, et 20 à 30 m³/ha dans les futaies résineuses. L’augmentation du volume de bois vivant (objectif de 350-400 m³/ha) est également clé pour alimenter le flux de bois mort futur.
La stratégie suggère d’adopter une approche combinant « land sparing » (zones protégées strictes) et « land sharing » (intégration du bois mort en forêt de production). Des itinéraires techniques sont proposés pour désigner les zones en libre évolution et les arbres-habitats, en tenant compte des risques pour la sécurité publique (avec une collaboration avec le secteur des assurances pour une approche plus cohérente de la responsabilité).
Vers l’avenir : sensibilisation, recherche et gouvernance
Pour concrétiser cette stratégie, plusieurs chantiers sont identifiés :
- Révision des normes légales et mécanismes de soutien (subventions, certifications) pour les arbres-habitats et zones en libre évolution.
- Programmes de communication et formation ciblés pour les propriétaires, professionnels, décideurs politiques et le grand public, insistant sur les avantages du bois mort et la désensibilisation des préjugés.
- Soutien à la recherche scientifique sur la biodiversité saproxylique, les processus biologiques et les impacts du bois mort, en Wallonie.
- Recherche sur les enjeux socio-économiques, incluant une quantification précise des bénéfices et coûts des pratiques de conservation.
- Développement d’un monitoring biologique des forêts wallonnes, allant au-delà des ressources forestières classiques.
- Amélioration de la communication et du partage d’informations sur l’état de la forêt et la biodiversité associée.
Ce rapport conclut qu’une approche collective et transdisciplinaire est indispensable pour l’avenir des écosystèmes forestiers wallons, permettant de développer des diagnostics partagés et des consensus sur les objectifs à atteindre. Le bois mort n’est pas une perte, mais un investissement dans la fertilité, la productivité et la résilience de nos forêts, garantissant qu’elles continuent de nous fournir leurs multiples contributions essentielles pour les générations futures.

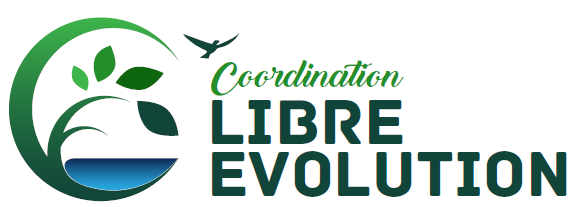


Commentaires récents